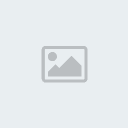| | | Enchantements |  |
| | | Auteur | Message |
|---|
Rena Circa le Blanc
Plume Novice

Messages : 25
Date d'inscription : 18/01/2015
 |  Sujet: Enchantements Sujet: Enchantements  Lun 26 Jan 2015 - 22:46 Lun 26 Jan 2015 - 22:46 | |
| Archie Année 3245. Un peu avant que le jour se lève sur Terrapolis, toutes les petites gens sortaient de leur torpeur et s’agitaient, en vue de remplir leurs besognes quotidiennes. Archie Neros faisait partie de ces petites gens. Il se levait, se douchait, déjeunait et se préparait pour se rendre à son travail, situé non loin de la grande base aérospatiale de Terrapolis.
Physiquement, Archie n’était pas bien grand, et son goût prononcé pour le chocolat en faisait même un homme aux allures légèrement rondelettes. Mis à part ses poignées d’amour, et ses cuisses tout de même plus épaisses que la moyenne, Archie, sans être beau, avait un certain charme... il était globalement bien proportionné, sauf lorsqu’il mettait ses lunette qui lui réduisaient alors les yeux à deux minuscules fenêtres vert-de gris. Du haut de ses trente-quatre ans, Archie était aussi un homme humble, qui ne cessait de parler de son métier comme d’une banale mécanique, comme tout bon carrossier qui ne cherche pas à vendre plus qu’il ne devrait. Mais voilà, Archie n’était pas qu’un bon carrossier.
Archie Neros était le grand inventeur des Arthuriens, la dernière génération de véhicules de l’armée de Terrapolis. En effet, cet homme à l’aspect de citoyen tout à fait normal, avait été un des premiers concepteurs de ces appareils dont la puissance et la vitesse étaient inégalables. En quelques mois, il avait eu l’idée de créer des moyens de transport, à l’image de l’homme, et qui pourrait en quelques secondes, franchir ce qu’un avion de chasse parcourait en sept minutes. De plus, elles pouvaient aller dans l’eau et dans l’espace, en moins de temps qu’il en fallait pour le dire. Bien sur, ces choses étaient des moyens de défense contre les attaques de races extra-terrestres, mais il n’osait envisager que cela devienne des armes… c’est pourtant le sort qui frappa ces machines gigantesques. Mais Archie préférait oublier ce côté néfaste de sa vie. Il construisait des machines. Après tout, ce qu’on en faisait ne le regardait pas, c’était ce que stipulait son contrat. Celle dont il était le plus fier était l’Osiris, un bijou de technologie, d’environs cent quatre vingt mètres de haut, pour quelques trois cent tonnes. Il pouvait transporter jusqu’à soixante-dix passagers sans être démis de sa vitesse, et traverser trois galaxies avant de montrer des signes de fatigue. Archie Neros, bien que l’excellent inventeur de ces instruments redoutables, se voulait néanmoins un honnête et simple citoyen.
Le jour n’était pas encore tout à fait levé, qu’il avait déjà enjambé les quelques dizaines de mètres qui le séparaient de ses locaux. Son petit bureau d’inventeur s’y trouvait, au deuxième étage de la grande tour de verre où il avait pris ses quartiers. Sa secrétaire – une jeune brune aux yeux verts, de dix ans la cadette d’Archie, qui mettait en avant, sans paraître vulgaire, ses charmants atouts – l’accueillait alors, avec un café vénusien agrémenté d’une légère cuillère de sucre neptunien, comme il l’appréciait tant. Parfois, il agrémentait son petit déjeuner d’un de ces petits gâteaux typiques de l’Alpha du Centaure. Il prenait alors son café en regardant la base s’éveiller en douceur avec les premiers rayons du soleil. Puis la journée commençait, il prenait le temps de voir les essais que l’on faisait sur ses dernières créations, les ajouts ou suppressions qu’on lui demandait de faire et les quelques améliorations qu’il pourrait entreprendre le lendemain, sur d’autres machines. Puis il rentrait, le soir, dans son petit appartement de fonction, à l’intérieur de la zone militaire – mesure de sécurité, au cas où quelques malhonnêtes personnes veuillent sa peau ou son cerveau – et plutôt solitaire, parmi tous ces logements d’officiers, sergents et colonels. De temps en temps, il traînait sur le galac-net, mais ne perdait pas de temps, et allait vite se coucher.
Quand il était enfant, Archie était l’ombre de sa mère. Il la regardait tout le temps, attacher ses cheveux en un chignon d’où dépassaient quelques mèches, faire tranquillement le nœud de son tablier, sortir la planche d’un des tiroirs de la petite pièce, et cuisiner. Il pouvait passer des heures à détailler le moindre de ses gestes, quoi qu’elle fasse. Il la regardait découper la salade, éplucher les légumes, étaler de la pâte feuilletée, rincer les fruits, mélanger les saveurs, agrémenter de quelques sauces et épices. Parfois, elle lui faisait gouter ce qu’elle préparait, et Archie partait alors dans une autre dimension.
Ce métier le faisait rêver, il écrivait déjà dans un carnet de recettes, à l’âge de huit ans, les plats exquis et raffinés qu’il préparerait pour ses convives à venir, dans un restaurant qui aurait un nom de dieu terrien, d’étoile ou de galaxie. Il se voyait en dessin sur une grande affiche, un immense sourire aux lèvres, portant un plateau dont une large cloche argentée aurait caché le plat. Pour Archie, manger, c’était la vie.
Arthur, le père d’Archie était aviateur. Pilote de chasse, plus exactement. Mais lors d’une prise d’assaut de la base de Terrapolis par les évadés de la grande nébuleuse d’Andromède, il fut un des premiers envoyés à l’assaut, et il ne revint jamais. Alors, se détournant des plats qu’il aurait pu cuisiner, un jour, à des milliers d’invités qui se presseraient pour le voir et lui serrer la main, Archie se tourna vers le domaine de la guerre. Il savait que c’était ce que feu son père aurait souhaité. Il ne voulait pas le décevoir.
Aujourd’hui est un jour comme les autres. Comme les autres, ou presque… Toute la nuit, Archie a travaillé sur un nouveau modèle, plus petit et plus vif que les précédents. Il ne fait que le tiers de la taille d’un modèle standard. D’ailleurs, les poches bleues sous ses yeux sont significatives de son état. Il arrive dans son bureau, en nage, les cheveux collés sur le front, et pâle comme un linge. Et alors que sa secrétaire arrive pour lui tendre son café habituel, il passe à côtés d’elle sans la voir, et va s’affaler dans son fauteuil, face à la base, qui ne profite pas encore de l’ondée de lumière qu’apportera le soleil. Complètement groggy, il observe le spectacle qui s’offre à lui.
_ Qu’est-ce que j’ai fais, bon sang… qu’est-ce que j’ai fais ?
_ Vous avez mal dormi monsieur ? Demande mademoiselle Yarra.
_ Vous voulez savoir une chose, jeune fille ? Ce métier, c’est un métier de con.
De la part d’un homme qui n’a jamais prononcé la moindre vulgarité, et qui n’a même jamais paru fatigué ou énervé de sa vie, cela choque profondément la jeune femme, qui reste interdite, la tasse de café dans une main, et la sucrière dans l’autre, derrière son patron.
_ Vous vous rendez compte ? Je viens de passer une nuit entière à bosser sur une machine.
_ C’est votre métier, monsieur.
_ Mais j’aime pas les machines ! répond-il dans un souffle irrité. Elles me font chier, les machines. Elles sont froides, elles sont indélicates, elles sont abruptes, elles sont insensibles, elles puent le kérosène, je hais les machines, je vomis les machines !
_ Mais monsieur… entame mademoiselle Yarra.
_ Mais monsieur quoi ? Monsieur quoi ? A l’heure qu’il est, je devrais être à la tête du plus grand restaurant de la galaxie, ma petite ! Au lieu de passer mon temps à bouffer des cochonneries des autres planètes, je devrais éparpiller les merveilles qu’a la Terre à offrir à cet univers qui lui tend les bras. Et regardez ce que je fais : je fabrique des choses, qui n’ont pas de cœur, qui n’ont aucune saveur, et qui transpirent la mort, à travers leur acier inoxydable. Au lieu d’aimer la Terre pour ses plats qui n’ont rien à envier à la constellation du Dragon, les autres mondes la détestent pour ses armures mobiles que j’ai imaginées, comme si ça allait sauver mon père qui est déjà mort. Et toi là haut, si tu m’entends, ton fils a fait ce que tu voulais, et peut-être bien plus encore. Ça y’est ? T’est content, hein ? T’ES CONTENT ?
Le silence tombe lourdement sur le duo, dans le bureau. La jeune femme reste encore quelques instants, hébétée par le discours de l’homme qui lui tourne le dos.
_ Qu’allez vous faire alors ? Demande-t-elle finalement.
_ J’en sais rien, pour être honnête. Ça fait tellement longtemps que j’ai pas touché une planche à pain que je ne saurais même pas si je suis capable d’en faire un.
_ Et vos machines ? Vous allez les détruire ?
_ Ca serait dommage qu’on réduise à néant quinze ans de recherches et d’invention, pour une subite envie de passer de la guerre à la dégustation.
_ Et si vous en gardiez une ?
_ Comment ça ?
_ Vous gardez l’Osiris, et vous en faites votre restaurant.
Il se met à réfléchir intensément. Finalement, il trouvera peut-être à saluer la mémoire de son père et de sa mère…
_ Peut-être bien, dit-il alors doucement, peut-être bien…
Dernière édition par Rena Circa le Blanc le Lun 26 Jan 2015 - 22:47, édité 1 fois | |
|   | | Rena Circa le Blanc
Plume Novice

Messages : 25
Date d'inscription : 18/01/2015
 |  Sujet: Re: Enchantements Sujet: Re: Enchantements  Lun 26 Jan 2015 - 22:46 Lun 26 Jan 2015 - 22:46 | |
| Une Maison dans les Nuages Une nuit, j'ai fais un étrange rêve. C'était un rêve, où toutes les saveurs du monde étaient mélangées. Je marchais dans une forêt dense, dont les feuilles des arbres gigantesques me protégeaient de la chaleur du soleil, tout en laissant filtrer sa douce et merveilleuse lumière. Et il y avait cette maison de rêve.
Elle serait faite de bois, vue de l’extérieur. Un bois joli à regarder, un bois clair et doux au touché, sans écharde à se planter dans les doigts quand on passe la main dessus. Elle ressemblerait à une cabane d’enfant, simple et innocente, avec ses quatre murs et son toit. Il y aurait probablement une petite cheminée, pour se blottir au coin du feu les soirées d’hiver, et lire un bon livre ou manger des marrons grillés. Le toit serait plat et il y pousserait tant de plantes qu’on ne le verrait plus. Elle serait installée à la cime d’un baobab, ou bien dans des nuages, à un endroit d’où on pourrait regarder le monde tourner sans être touché par ses malheurs, très loin des conflits et de toutes ces choses qui nous sont inutiles.
A l’intérieur, cette maison serait plus grande et pleine de nouvelles choses à découvrir. Les murs seraient en marbre, comme ceux des palais, et des plantes en or y grimperaient pour faire des rosaces mouvantes. Il y aurait une cuisine, pour préparer des bons plats et des gâteaux. Il y aurait un petit salon pour prendre le thé, en compagnie de ses amis. Il n’y aurait pas de chambre parce qu’on passerait les nuits à regarder les étoiles, allongés dans l’herbe verte et parmi les plantes qui auraient recouvert le toit. Il y aurait une salle de bal, pour y inviter les Dieux de l’Olympe, d’Azgard et de Thèbes.
Il y aurait les bruits du vent, et le chant des oiseaux. Le jour, les tourterelles, les rossignols, les rouges-gorges, les oies sauvages. La nuit, les hiboux qui répondent aux chouettes. De temps en temps, on pourrait entendre les cordes de ta guitare, ou les touches de ma machine à écrire. Et parfois, en prêtant bien attention, on pourrait même entendre les bruits d’en bas.De temps en temps, il n’y aurait rien. Seulement le silence, doux et apaisant, que rien ne viendrait troubler sous peine de briser un instant de quiétude.
Il n’y aurait jamais eu ni sang, ni larmes, ni toutes ces idées noires qu’on peut avoir quand se demande ce qui ne va pas chez nous, ce qu’on a manqué, ce qu’on a fait.il n’y aurait pas de guerre, pas de misère. Il n’y aura pas de regrets non plus, ni de remords. Il y aurait bien quelques erreurs du passé, mais seulement celles qui nous auraient fait avancer, et chaque souvenir serait gai et doux.
Il n’y aurait pas de peur viscérale, de celles qui nous clouent sur place au lieu de nous pousser à aller de l’avant. Il y aurait bien, parfois, quelques moues boudeuses, mais pas de mots méchants, et je m’efforcerais de ne jamais dire de grossièretés. Il n’y aurait pas d’idées avortées, pas de chagrin d’amour, pas de perte.
J’y construirais des rêves et toi des théories. J’y fabriquerais ton atelier, pour que tu joues avec tes outils, à l’inventeur de mille et unes machines futuristes. J’y construirais ma bibliothèque, dont les étages seraient infinis, où tous les livres du Monde seraient rangés, et sur une barre horizontale, se trouverait une échelle immense, qu’on pourrait faire glisser à volonté pour s’envoler dans les imaginaires des auteurs qu’on aurait choisis.
J’y construirais une grande serre, pour y faire un potager et y voir pousser une jungle immense au milieu de laquelle coulerait une rivière. J’y construirais une machine à remonter le temps, pour revivre tous nos bons moments.
D’hier, il y resterait de beaux souvenirs, empreints de couleurs, d’odeurs et de sons. Il y resterait cette odeur, ce parfum dont on a toujours le nom sur le bout de la langue, sans jamais pouvoir le trouver. Il y resterait ces couleurs qu’on savait tant apprécier. Il y resterait quelques jouets d’enfant qui ont marqué toute une vie, des objets qui ont été les témoins d’un grand tournant, des accessoires dont le simple contact visuel, tactile ou auditif, rappelle les meilleurs moments de la vie.
Il y aurait toi, toi qui bricolerais, toi qui aurais des projets pour changer le monde, toi qui ne cesserais d’avoir des idées lumineuses, toi qui arroserais tes plantes sur le toit et dans la serre de cette maison idéale, toi qui viendrais m’embêter pendant que je lis, toi qui forcerais les dieux de l’Olympe, d’Azgard et de Thèbes à quitter notre salle de bal pour être enfin tranquille et avoir ce silence apaisant pour méditer. Toi, qui froncerais les sourcils, pour gronder le chat qui aurait renversé ton café, mais qui retrouverais ton air gentil en prétextant qu’un chat ne mérite pas d’être grondé. Toi qui ferais battre le cœur de cette maison à chaque foulée, à chaque respiration, à chaque sourire, à chaque idée. Si toi, tu n’es pas dans cette maison, alors je ne veux pas y être non plus. | |
|   | | Rena Circa le Blanc
Plume Novice

Messages : 25
Date d'inscription : 18/01/2015
 |  Sujet: Re: Enchantements Sujet: Re: Enchantements  Lun 26 Jan 2015 - 22:51 Lun 26 Jan 2015 - 22:51 | |
| Ibisérions
A cette époque-là, sur terre, deux peuples se partageaient le territoire. Il y avait les Tamarites, qui vivaient dans les déserts et les contrées verdoyantes, et les Rivelains qui avaient colonisé toutes les plaines glacées du Nord et s’étaient éparpillés à travers les océans. La Terre, d’ailleurs, ne portait plus un tel nom depuis des milliers d’années. Les temps anciens avaient emporté ce nom avec eux. Pour l’ère nouvelle qui s’était offerte à ce monde, terre avait été surnommée Agaedis par les tamarites et Nomira par les rivelains, ce qui signifie « la douce et puissante ».
Grands et robustes, les tamarites arboraient une couleur brune, propre à leur exposition à cette étoile brûlante, autour de laquelle le monde faisait ses rondes perpétuelles. Ils étaient certes quelque peu humanoïdes, mais l’on pouvait déceler leur côté canin à travers leurs corps taillés pour l’endurance. Ils arboraient aussi un museau proéminent, ainsi que deux grandes oreilles duveteuses, qui captait le moindre son à des kilomètres lorsqu’ils étaient en chasse. Leurs pieds et mains étaient munis de griffes longues et effilées, et leurs mâchoires puissantes étaient garnies de dents larges et longues. Gouvernés par un roi et une reine, dans le château, situé tout en haut du plus haut volcan du monde, d’où ils devaient veiller sur leur peuple, les tamarites vivaient dans de larges villes, qu’ils avaient reconstituées à partir des cités humaines des temps anciens. Les monarques se succédaient de façon naturelle, et seul l’aîné avait le droit de gouverner. La sélection du compagnon ou de la compagne, se faisait avec le cœur, et les frères et sœurs de l’aîné, s’il y en avait, devenaient ainsi ses dauphins. En terme tamarite, ils étaient les canines de leur futur roi ou future reine. L’armée était la partie la plus importante du peuple tamarite. Les finances n’existaient pas, ils avaient décidé que tout un chacun était chez lui n’importe où, du moment qu’il mettait la main à la patte, et que ce qui était à l’un appartenait à tous… la seule exception était le couple bien évidemment.
Ce peuple vivait en parfaite harmonie, il n’y avait nulle guerre civile, nul conflit interne, nulles représailles. Sédentaire et monogame jusqu’à la fin de sa vie, le tamarite ne vivait que pour ceux qu’il considérait comme étant ses frères et sœurs. Les jours étaient rythmés par les chasses quotidiennes, les six repas journaliers et les enseignements du maniement des armes. Les enfants étaient élevés par le village où ils voyaient le jour, et souvent, un tamarite vivait à jamais là où il avait grandi. Ce n’était pas une nécessité, bien sur, mais l’harmonie était telle dans ce peuple, que leur désir n’était pas de quitter leurs amis, leurs parents, leurs frères et sœurs.
Lorsqu’il avait l’âge de chasser, le jeune tamarite avait le droit de passer la voltige extrême. Les adultes les plus aguerris partaient capturer l’une des créatures les plus redoutées du monde, et la présentait au jeune. Ce dernier devait faire ses preuves en tuant le monstre à la fin d’un duel. Cette épreuve faite, il avait l’honneur d’entrer dans l’âge adulte, le droit de choisir celui ou celle qui partagerait la fin de ses jours, ainsi que le travail qu’il exercerait et la ville où il vivrait.
Leur grande force résidait en leur remarquable loyauté envers leur peuple, et en cette touchante affection qui les liait, tels les membres d’une seule et même grande famille. Jamais ils ne laissaient l’un des leurs derrière eux, jamais ils ne cédaient à de basses ambitions si c’était pour porter atteinte à l’un des leurs, jamais ils ne laissaient la jalousie les emporter… ils n’étaient pas les plus intelligents, mais les plus forts et les plus courageux, les plus droits et les plus fiers, les plus respectueux et les plus doux.
Les rivelains, souples et fins, plutôt allongés, étaient taillés pour la vitesse plus que pour la force. Mais ils avaient fait de cette faiblesse un atout, et leurs techniques de chasse avaient évolué avec eux, les mots d’ordres pour cette partie-là de leur vie étaient la discrétion et la surprise. Leur pelage blanc, fait pour se fondre parmi les neiges et les vagues, se trouvait parfois tacheté de gris, et leur regard étaient noirs comme les ténèbres. Les rivelains n’étaient pas aussi robustes que leurs voisins diurnes, les tamarites. Certes plus légers, ils étaient aussi de composition plus faible. Leur museau était court et arrondi, de même que leurs oreilles. De plus, ils possédaient une longue et fine queue qui leur servait de balancier, lorsqu’ils se lançaient dans une course effrénée, où ils atteignaient souvent une telle vitesse de pointe qu’il en devenait difficile de les distinguer clairement. Mais leurs crocs étaient moins longs et leurs doigts ne possédaient que des ongles, à peine solides. Ainsi, ils avaient trouvé le moyen de palier à cette faiblesse, et leurs outils de tous les jours et leurs accessoires de chasse étaient donc largement à la hauteur de la puissance de leurs voisins canidés.
Par leur aspect plus gracile que celui des tamarites, ils avaient trouvé un autre domaine, dans lequel ils excellaient : c’était la science. Ils avaient bâti là où les hommes des temps anciens avaient échoué, et ils avaient réussi dans le domaine de l’intelligence, là où leurs voisins pêchaient. Leur esprit labyrinthique parvenait à bout de toutes les énigmes, résolvait en quelques secondes les pires problèmes mathématiques, et pouvaient passer quelques minutes à réaliser un pamphlet que même des hommes auraient pris plusieurs dizaines de jours à écrire, voire à imaginer. Ils étaient passés maîtres dans le maniement des mots, et dès qu’un enfant était en âge de créer des stratégies de chasses, il était abandonné dans la nature, livré à lui-même, et normalement capable de se défendre, de retranscrire ce qu’il remarquait et de vivre tout seul. Ainsi, le jeune rivelain découvrait les richesses du monde qui l’entourait, décryptait les signes de la nature pour s’en faire une arme, tant morale que physique, et souvent, préférait la vie de nomade à celle de sédentaire, pour pouvoir répondre à cette soif de connaissances qui l’habitait.
Solitaires dans l’âme, ils ne pouvaient vivre en groupes de plus d’une dizaine d’individus, car sitôt un trop grand nombre atteint, ils ne pouvaient s’empêcher de se haïr les uns les autres. Contrairement au tamarite qui ne pouvait vivre sans ses pairs, le rivelain n’était pas capable de supporter les siens. Il obtenait un meilleur résultat s’il travail seul plutôt qu’en groupe. Pourtant, il arrivait parfois que certains se réunissent pour se livrer à de grandes fêtes. Cela pouvait avoir lieu n’importe où et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils n’avaient pas besoin de raison pour se rassembler et se livrer à leurs deux jeux préférés : les débats philosophiques et les joutes verbales. C’était sans doute le seul moment de paix et de sérénité qu’il pouvait y avoir entre les membres de ce peuple, car ils s’enrichissaient mutuellement de savoir. Leurs appels au défi étaient dénués de toute animosité, et ils prenaient plaisir à jouer, peu importait s’ils gagnaient ou perdaient.
Par leurs origines primitives – les tamarites étant les descendants de races canidae et les rivelains, de races felidae – ainsi que par les grandes différences qui les séparaient, les deux peuples, sans se vouer une haine farouche, n’avaient pas le moindre contact l’un avec l’autre. Bien sur, chaque peuple connaissait l’existence de l’autre. Chez les félins, les tamarites étaient décrits comme étant une race inférieure mais dont la puissance avait été donnée par les étoiles et pouvait défier celle des montagnes. Chez les canidés, les rivelains étaient connus, par des légendes diverses et variées, pour être les immortels esprits des temps anciens, fourbes mais ayant accès à toutes les connaissances du passé, du présent et du futur.
D’ailleurs, ils ne souhaitaient pas réellement se rencontrer un jour, car ils savaient tous, grâce à cet inconscient collectif qui régissait leur façon de se comporter, que s’il devait y avoir une guerre entre les deux peuples, nul n’en sortirait vivant. La vitesse de l’éclair des rivelains n’avait d’égale que la force colossale des tamarites.
Tamarites et Rivelains vivaient depuis des centaines d’années, sans le moindre contact les uns avec les autres. Mais un jour, tout bascula avec l’apparition d’une créature qu’ils n’avaient jamais vu auparavant, et qui se mis à arpenter le monde, sans cesse. L’être avait une forme humanoïde, lui aussi. Cependant, il ne ressemblait en rien aux félins ou aux canidés. Son visage recouvert de plumes rouge où luisaient deux yeux d’un noir absorbant, était à moitié caché par une large cape noire, qui tentait de dissimuler aussi d’immenses ailes dans son dos, et au lieu d’avoir un museau comme les autres, il était pourvu d’un long bec noir légèrement recourbé vers le bas.
La première fois qu’ils le virent, tamarites comme rivelains, prirent peur d’une telle chose, qu’ils considéraient chacun comme un mauvais présage. L’apparence d’une nouvelle espèce humanoïde était redoutée, pour tous, car elle signifiait la fin de leur ère. Dès qu’ils l’apercevaient, chaque membre des deux peuples prenait ses jambes à son cou et se cachait des yeux de la créature. De crainte, leur sentiment passa à légèrement méfiant, puis certains osèrent l’approcher. L’être disait se nommer Aïs, mais les uns le surnommèrent « Darrim » et les autres l’appelèrent « Noctae » qui signifiait dans chacune des deux langues « le mauvais auspice ».
Pourtant, les jours passaient, et nul ne vit la fin du monde arriver. L’être sillonnait leur planète, sans trouver de pied-à-terre, rejeté par l’un et l’autre des deux clans. Les tamarites, plus simplets que leurs voisins rivelains, finirent par tolérer la présence de l’étranger, qui ne perdit pas de temps à s’installer parmi eux, presque comme l’un des leurs. Lorsqu’il se sentit en confiance du peuple canidé, il décida d’ôter son voile qui recouvrait la plus grande partie de son corps, et l’on put voir que ses membres inférieurs et supérieurs étaient aussi longs, noirs et effilés que son bec, et se terminaient par des serres comparables à celles des oiseaux des marais. Les tamarites lui découvrirent une personnalité, aussi douce que son esprit était vif.
Découvrant par certains racontars des tamarites fiers de leur nouvelle situation, ce qu’il était advenu de l’étranger, et y trouvant une partie d’eux-mêmes dans son intelligence et sa finesse d’esprit, les rivelains se mirent à jalouser l’autre peuple. Beaucoup décidèrent de rompre avec leurs principes de ne jamais approcher les tamarites, cherchèrent à convaincre l’étranger d’abandonner les faibles d’esprit pour s’entretenir spirituellement avec eux et leur en apprendre plus qu’ils ne pouvaient déjà en savoir. Chacun des deux peuples se mit à ériger des contes et des représentations, tant visuelles qu’orales, de celui qui avait été communément appelé « le Grand Ibis ». Tous voyaient un avenir où le Grand Ibis les guiderait sur une voix pleine de sagesse et de vigueur grandeur. On oublia l’époque où il était méprisé, on oublia même l’époque où il n’existait pas.
C’était sans compter sur le grand ibis lui-même. Car un jour, après des décennies de communion entre les deux peuples, il disparut. Nul ne sut ce qu’il était advenu de lui, et nul ne put retrouver sa trace.
Alors les deux peuples, qui avaient fini par tisser des liens, malgré leurs profondes différences, au lieu de prendre de nouvelles distances, se mirent à pleurer ensemble leur bienfaiteur. De nouvelles légendes virent le jour, et décrivaient l’histoire d’un oiseau rouge tombé du ciel, réunissant par ses paroles et sa simplicité, deux peuples qui étaient voués à ne jamais s’accepter. Certains se demandèrent si cet être n’avait pas réellement été ce présage d’une nouvelle ère qu’ils avaient pressenti lorsqu’ils l’avaient vu pour la première fois. Ce n’était pas un signe mauvais, bien au contraire. C’était celui d’une ère mêlant la force des tamarites à l’intelligence des rivelains. Les êtres apprirent les uns des autres, le nouveau souverain tamarite choisit une rivelaine pour épouse, et du mélange entre ces deux peuples, n’en fut plus qu’un. Les Ibisérions. Et ils écrivirent ensemble les débuts de notre ère.
| |
|   | | Rena Circa le Blanc
Plume Novice

Messages : 25
Date d'inscription : 18/01/2015
 |  Sujet: Re: Enchantements Sujet: Re: Enchantements  Lun 26 Jan 2015 - 22:51 Lun 26 Jan 2015 - 22:51 | |
| Deux âmes
Au matin du premier jour de notre histoire, Armand aperçoit Marguerite. En la voyant, il se dit que cette créature est la plus belle que le monde ait porté. Certes, elle est vraiment énorme, et ses formes exagérément arrondies lui donnent un aspect de bête difforme. Mais lui, la trouve gracieuse, élégante dans ses multiples tournoiements, pirouettes et autres acrobaties qu’elle exécute autour de lui, sans même se rendre compte de son existence tant il est petit comparé à elle. La grosse Marguerite ressemble à une danseuse étoile, tant elle est en harmonie avec ce qui l’entoure.
Il se délecte avec passion de ses mille mouvements, il n’a de cesse de l’observer aller et venir, avec un regard chargé d’amour pour l’immonde chose qui se trémousse devant lui. Ses faits et gestes sont scrutés dans leur moindre détail, et de grotesques et laids, sitôt passés par les yeux d’Armand, deviennent légers et graciles. Marguerite est la plus belle création de l’univers, qui pourrait détourner son regard d’elle ? Pas Armand en tout cas. Il aimerait tant être comme elle, et l’accompagner dans ce ballet qu’elle exécute seule et sans compagnon. Lui, si petit, et elle, si grosse !
Au matin du deuxième jour de notre histoire, Marguerite sent une force invisible peser sur elle, alors qu’elle revient exécuter à nouveau ses prouesses physiques. Ce n’est pas un regard de prédateur. Du moins, pas celui d’un danger assez grand pour qu’elle en tienne compte. La créature qui l’observe sans relâche semble pourtant très intéressée par ses pirouettes. La créature, c’est Armand. Elle n’en a jamais vu des comme lui, tout petit par rapport à elle, si large qu’elle pourrait l’avaler quinze fois sans être rassasiée. Quel étrange animal, pourquoi la regarde-t-il ainsi ? Pourquoi suit-il tous ses mouvements ? Si ce n’est ni pour la manger, ni pour se joindre à elle dans cette danse, alors pourquoi reste-t-il à la regarder ?
Pourtant, il y a quelque chose dans cette observation simple, qui plait à Marguerite. Elle se sent belle, elle se sent aimée. Et pour ce simple plaisir, elle ne peut s’empêcher de danser encore, et met plus de force et de conviction dans cette danse.
Au matin du troisième jour, alors que Marguerite revient en ces lieux pour accomplir sa danse une énième fois, elle se rend compte qu’Armand est déjà là.il est arrivé avec les premiers rayons de l’astre diurne, et se veut à nouveau le seul témoin du spectacle fabuleux. Elle accomplit bien quelques nouveaux déhanchés, mais cette fois déconcertée par ce même regard fixé sur elle, décide de s’approcher un peu, pour mieux l’observer, elle aussi. Son immense corps allongé franchit l’espace qui la sépare d’Armand en quelques secondes, et son œil, aussi gros que le poing de l’homme, fixe ce dernier avec intensité. Un instant, c’est lui qui est dérouté. Il se recule sur son embarcation, et Margueritte, heureuse de ce choc qu’elle a provoqué en lui, s’éloigne avec douceur et majesté.
Un soir, bien longtemps après le début de notre histoire, Armand retrouve enfin Margueritte. Il a eu si peur qu’il a quitté l’endroit, et pendant des années, l’a laissée aux bons soins de l’océan qui l’avait vue naître. Il s’est donné beaucoup de mal pour oublier cette rencontre. Mais il n’y est pas arrivé. Il a fait sa vie, avec une femme qui lui ressemble, mais n’a jamais cessé de penser à Margueritte.
Alors, un jour, il a décidé de retourner sur le lieu de leur première rencontre. Pendant longtemps, il l’a attendue, dès l’aube, jusqu’au crépuscule. Elle n’est pas venue. C’est un soir qu’il l’a retrouvée… ou plutôt, c’est Margueritte qui a retrouvé Armand ce soir-là. Elle tournoie autour du bateau, avec frénésie, et reprend le ballet qu’elle avait accompli sous ses yeux ébahis lors de leur première rencontre. Lorsqu’il la voit, alors qu’il avait perdu tout espoir de la retrouver un jour, Armand se sent vivre de nouveau. Il reconnait ses formes énormes, il retrouve cette grâce qu’il est le seul à voir. Et il pleure.
Au terme de notre histoire, Armand est seul.de nouveau, il pleure, mais cette fois, ce n’est pas de joie. Il pleure la dépouille de cette si belle, de cette si merveilleuse Margueritte qui avait pris l’habitude de danser pour lui dans les eaux qu’elle remuait, entre l’écume et les vagues qu’elle créait par sa force et ses mouvements. Armand avait abandonné sa vie d’humain pour la passer à bord de son voilier, en compagnie de Margueritte, qui avait apparemment fait la même chose de son côté. Il ne se passait pas un jour sans qu’ils ne s’échangent des regards complices, sans que lui n’offre à sa belle du poisson, ou qu’elle ne bouge pour lui.
Aujourd’hui, sur une plage de sable blanc, Armand est un vieillard accroupis qui pleure, aux côtés de la carcasse de la dernière baleine bleue.
| |
|   | | Rena Circa le Blanc
Plume Novice

Messages : 25
Date d'inscription : 18/01/2015
 |  Sujet: Re: Enchantements Sujet: Re: Enchantements  Lun 26 Jan 2015 - 22:52 Lun 26 Jan 2015 - 22:52 | |
| L'Objet
J’aime les voir aller et venir devant moi. Ces milliers de passants affairés, pressés, perturbés par leur quotidien. Moi, je les regarde, du matin au soir, marcher, trotter ou bien courir sur ces dalles de marbre qui font les trottoirs de la ville. D’une part, ils me font peur. Si la vie se résume à ça, je ne veux pas la vivre. Etre pressée toute ma vie, non merci. D’autre part, ils m’intéressent. Certains rient parfois, quand ils passent devant moi. Ce sont eux qui me donnent envie de partir à l’aventure et de les rejoindre, tous ces gens étranges. Il y en a qui s’arrêtent pour admirer mes formes effilées, avec des étoiles plein les yeux, comme si je les emmenais en voyage. Mais ils détournent le regard, pour retourner à leur vie, et m’oublient aussitôt.
Moi, je n’oublie aucun de leurs visages, qu’ils soient poupons ou ridés, doux ou bien rude. Je reconnaitrais la lueur dans les yeux de chacun, en attendant celui qui m’emportera avec lui… lorsque le soir tombe, et que les passants se font moins nombreux, je rêve de pouvoir m’échapper, pour découvrir le monde et voir si lui aussi, ne brille pas d’une certaine lueur.
En voilà un qui me regarde fixement. Depuis combien de temps me scrute-t-il ? Je n’en sais rien, je ne comprends pas le temps. Ses yeux, comme ils sont beaux ses yeux ! Oh s’il te plait, toi dont l’iris brille d’un éclat qui m’envoute, par pitié ne pars pas ! Garde-moi auprès de toi et je ferai tout selon tes désirs ! Je serai toute à toi, rien qu’à toi, pour toujours et plus encore ! Prends-moi dans tes bras et vivons enfin cette vie dont j’ai toujours rêvé. Cette vie ne peut pas être plus merveilleuse si elle se fait à tes côtés.
Toi, tu as cet éclat, cette chose qui brille au fond de toi, et qui me fait briller aussi quand tu me regardes. Ensemble, sans jamais nous séparer, comme si nous n’étions qu’un être, nous explorons le monde. Tu me fais vivre des aventures extraordinaires, visiter des contrées magiques, rencontrer des êtres hors du commun. Comme toi, oh mon beau voyageur, beaucoup ont cette lumière magnifique dans les yeux.
Et tu prends soin de moi, tout comme tu m’aides à prendre soin de toi. Mon beau voyageur, je voudrais tant que la vie ne coule pas si vite dans tes veines, je voudrais tant te garder avec moi pour toujours, jusqu’à devenir tous deux de la pierre ou mieux, du sable. Ainsi, nous pourrions nous mêler l’un à l’autre à jamais ! Pourquoi mon existence est-elle vouée à dépasser la tienne ? Parée de toutes ces choses brillantes dont tu m’as sertie, je suis plus belle encore qu’au premier jour. Je le vois dans ton regard qui brille ardemment dès que tu le poses sur moi, et dans ta façon si douce de t’occuper de moi. Jamais je n’ai trop froid, jamais je n’ai trop chaud, jamais je n’ai à me plaindre de quoi que ce soit. Mon cher voyageur, tous ces rêves que je faisais en observant les gens aller et venir, tu les as réalisés. Comment te remercier de tant de bonheur, que tu me donnes ? Ah mon bel amour, si seulement je savais !
Tout est si parfait !
Mais voilà que je ne vois plus cette chose merveilleuse qui brillait jadis dans ton regard. Dans tes yeux, dès que tu me regardes, il n’y a plus rien. Combien de temps cela fait-il ? Des jours, des mois, des années ? Je n’en sais rien, le temps passe si lentement pour moi… ton regard s’est éteint, sans que je m’en rende compte. J’aurais dû le voir avant. Que t’arrive-t-il mon beau voyageur ? tu n’admires plus ma silhouette fine et élancée, tu ne t’occupes plus de moi aussi bien que tu le faisais lorsque nous avons été présentés l’un à l’autre, il t’arrive même de m’oublier, en proie au froid, au chaud et à toutes ces choses dont tu me protégeais. Tu as même cessé de me bichonner, et de me donner ce nom que j’aimais tant. A te voir, le dos tourné, à t’entendre soupirer, on dirait que tu ne veux plus de moi. Et moi qui ne peux te prouver à quel point je t’aime aussi fort que tu ne m’aimes plus… est-ce dont cela que l’on appelle la routine ? Est-ce l’extinction de l’amour ?
Inutile de se cacher la vérité. Je t’encombre, je le vois bien. Je suis pour toi plus un fardeau qu’autre chose. Ce n’est pas de la haine, que tu ressens pour moi. C’est juste l’absence d’amour. Tu m’ignores. J’ai beau faire tout ce que je peux pour attirer ton regard, rien n’y fait. Pourquoi me laisses-tu derrière toi, pourquoi m’oublies-tu ?
Tout est si horrible !
Et me voilà, seule, abandonnée derrière toi, à attendre désespérément que tu reviennes. Je devais m’y attendre. Tu m’as retiré toutes ces parures magnifiques, pour les donner à une autre, pour laquelle brillait ton regard, et qui la faisait briller à son tour. Tu l’as même affublée d’un petit surnom comme tu l’avais fais pou moi avant. Combien de temps suis-je livrée à moi-même, à subir le chaud, le froid, toutes ces choses que je ne connaissais pas grâce à toi ? Le temps me semble toujours aussi illusoire, et pourtant, il me frappe à coups de rouille, et me fait vieillir… de qui vais-je prendre soin, à présent ? Si je deviens inutile, alors à quoi bon avoir un but ? Je n’ai plus qu’à me laisser réduire à l’état de pierre, ou mieux, de poussière, pour venir te hanter quand il fera chaud, quand il fera froid.
Mais voilà qu’une ombre vient me chercher. Oh j’aimerais tant que ça soit la tienne ! Que ça soit ton regard qui me scrute. Mais ce ne sont pas tes yeux. Ce sont ceux d’un autre, un qui m’aimera vraiment.
Oh ! Toi, bel étranger, paré comme un guerrier de pied en cap, aime-moi comme je t’aimerai, ne m’abandonnes jamais, et tu peux être certain que je serai toujours là, à tes côtés, pour te protéger. Tu prendras soin de moi, contre la rouille, contre le chaud et contre le froid. Tu m’offriras mille bijoux qui me feront briller plus encore sous l’éclat ardent du soleil, et glacé de la lune. Tu me caresseras de tes douces mains, tu passeras de l’huile sur ma silhouette allongée, tu effaceras ces marques de rouilles sur mon corps argenté. Et comme tu prendras grand soin de moi, je prendrai aussi grand soin de toi. Je me dresserai devant toi, fière, mortelle, indestructible, car c’est ce que je suis ! Car si tu me laissais seule, oh mon beau chevalier, je ne servirais plus à rien. Car si tu n’avais pas besoin de moi, n’aurais plus personne à servir. Car je suis ta muse et toi mon poète. Car je suis la paix à la guerre que tu es. Car je suis l’épée qu’il manquait à ton fourreau. | |
|   | | Rena Circa le Blanc
Plume Novice

Messages : 25
Date d'inscription : 18/01/2015
 |  Sujet: Re: Enchantements Sujet: Re: Enchantements  Lun 26 Jan 2015 - 22:53 Lun 26 Jan 2015 - 22:53 | |
| Le Flacon
Tous les mois, je vais voir miss Terry Hamond, au Domaine de la Licorne, le vaste château entre vignes et forêts qu’elle habite dans le Morbihan. Elle n’aime pas que je l’appelle Miss, mais c’est plus fort que moi. Mon frère Eliot l’appelle « tante Terry », ma mère l’appelle « ma folle de sœur ». Mon père préfère ne même pas en entendre parler. Elle a un grain, certes, mais elle n’en est pas moins un être exceptionnel. Pour moi, elle a toujours été plus que ma tante. C’est ma meilleure amie, ma confidente, et je la considère aussi comme un guide spirituel. Elle habite une petite villa perdue entre les vignes et les forêts qui font partie de son domaine. Lorsque j’étais petit, j’allais chez elle pour les vacances, et elle me racontait ses aventures dans des contrées que je n’aurai jamais l’occasion de visiter. Je buvais ses paroles, je n’étais jamais lassé de l’écouter.
Pour mes grands-parents, le voyage était une façon de former la jeunesse, et ils n’avaient pas hésité à envoyer ma mère et sa sœur étudier successivement en Irlande, aux Emirats Arabes et au Japon. Tandis que ma mère qui avait besoin de se trouver un pied-à-terre, préféra ensuite la vie sédentaire, ma tante fit du voyage sa façon de vivre. Elle a fait beaucoup d’expédition dans sa vie, et c’est au cours d’une de ses premières explorations en solitaire qu’elle a rencontré celui qui deviendrait son mari, Bartholomé Hamond. A chaque fois qu’elle m’a raconté leur rencontre, j’ai eu l’impression d’entendre la plus belle histoire d’amour que le monde ait connu.
Elle faisait son premier voyage en Argentine, à jouer ses Indiana Jones au féminin pour la cinquième ou sixième fois. Pendant une excursion pour observer les troupeaux sauvages de lamas, elle fut surprise par le temps qui se couvrit très vite. Le seul endroit où elle put se réfugier était une petite auberge loin de toute civilisation, dont le toit fuyait, et où elle était la seule hôte à l’exception d’un homme peu débrouillard, qui avait cru le temps opportun pour peindre un décor argentin. Tous les deux étaient trempés jusqu’à l’os, à se chauffer tant bien que mal au coin d’un feu hésitant, entre deux roulement de tonnerre, et sous une pluie qui ne tarissait pas. L’un comme l’autre, incapables de dormir, ils se mirent donc à discuter le plus simplement du monde, passèrent la nuit à se conter leurs exploits respectifs, et n’eurent même pas besoin de chercher leurs points communs. Ils les trouvèrent immédiatement, et ils en avaient tant qu’ils décidèrent de faire la route du lendemain ensemble, lorsque la pluie cesserait enfin. Puis ils trouvèrent toujours plus d’excuses pour rester ensemble à voyager. Ils ne se quittèrent plus.
L’oncle Bart, écossais de corps et d’esprit, avait hérité d’une fortune considérable. Ne trouvant rien ni personne qui le retienne davantage et qu’il pourrait combler, il fit ce dont il avait toujours rêvé : découvrir le monde. Son mode de pensée était exactement le même que celui de ma tante, mais quand ils n’étaient pas d’accord, nous pouvions assister à un combat de caractères bien trempés, et le vainqueur n’était jamais le même. Il n’avait pas réellement été accepté par ma famille, mais je me souviens qu’il nous aimait bien, Eliott et moi. Souvent, je me demandais qui de miss Hamond ou d’oncle Bart, était le plus heureux de nous voir arriver au domaine de la Licorne, quand ils nous accueillaient pendant les vacances. Ce domaine, mêlant les larges étendues viticoles avec quelques hectares de nature sauvage et préservée de la déforestation, ils l’avaient acheté ensemble, juste après leur lune de miel. Ils l’avaient baptisé la Licorne, parce qu’ils estimaient être chacun un fragment de cet animal légendaire. Oncle Bart disait en représenter la puissance et le courage, et ma tante s’imaginait en incarner la douceur et le pouvoir de guérison.
Et surplombant le domaine, au bout d’une longue allée de graviers qui sépare les vignes des forêts, se trouve leur large bâtisse. Elle ressemble à un petit fort aux aspects anciens et presque hors du temps.
Au rez-de-chaussée, un large salon, assez vaste pour accueillir une soixantaine de personnes, aux trois baies vitrées donnant sur le petit jardin d’accueil. Cette pièce est digne d’un muséum, et les murs sont couverts d’objets chargés d’histoires. Au centre, se trouvent quelques étagères en verre, où sont exposés des dizaines d’artefacts que miss Hamond a ramenés de ses multiples voyages à travers le monde. Il y a même quelques uns des fossiles qu’oncle Bart avait aidé des paléontologues à déterrer. Chaque objet est accompagné d’une légende, qui rassemble sa description, l’endroit et l’époque où il a été trouvé, et la brève histoire qui le relie sentimentalement au couple. Généralement, c’est oncle Bart qui a légendé les objets.
Juste derrière le salon, se trouve une cuisine, petite mais très chaleureuse grâce à la présence d’une petite cheminée. Il y a une table et six chaises. Miss Hamond a toujours préféré prendre ses repas et ses goûters ici. Je pense qu’elle se sent plus tranquille. Un frigo, un four, et quatre plaques de cuisson, au gaz. Pas de machine à laver, ni de micro-ondes. Ma tante préfère cuisiner elle-même ses plats, et aime à faire la vaisselle, comme elle le faisait jeune. Elle n’a jamais vraiment aimé le changement.
La cuisine se termine là où commence une grande serre. Les plantes ont toujours su éveiller la passion et la curiosité de l’oncle Bart. Il pouvait passer des journées entières à observer des abeilles butiner ses fleurs, et il faisait parfois quelques tests avec certaines plantes. Je me souviens qu’il avait ramené du peyotl du Mexique, parce qu’il trouvait quelque chose de relaxant à en sentir le parfum et à en observer les courbes.
Au premier étage se trouvent trois ou quatre chambres. Étant postées au-dessus du salon, elles sont gigantesques. Dans chacune d’elles, un immense lit à baldaquin, des armoires dignes de Gulliver, et une grosse commode assortie d’un large miroir. Il y a même la place pour y mettre un sofa et deux fauteuils. Chacune d’elles possède salle d’eau avec une baignoire et une douche, ainsi qu’un cabinet de toilettes.
Le dernier étage n’en est pas vraiment un, il s’agit d’un vieux grenier où ma tante et mon oncle entreposaient des livres et quelques vieux vêtements, qui ne semblaient pas leur servir à grand-chose. Il y avait aussi des coffres, mais je n’avais jamais osé fouiller à l’intérieur pour savoir ce qu’ils recelaient. J’étais trop bien éduqué, dit-on. Quand j’étais petit, je prenais ma couette de lit et mon oreiller, et venais dormir dans cet endroit plutôt que dans la chambre qui m’était réservée. J’y étais plus à l’aise. Il y avait un hublot, d’où je pouvais observer la nature qui entourait le château, et je me souviens avoir passé de nombreuses nuits blanches, à force de regarder les animaux sauvages vaquer à leurs occupations.
Quand je n’observais pas la vie du dehors, je lisais les livres d’oncle Bart, qui parlaient le plus souvent de botanique, de préhistoire ou de vie sous-marine. Ces ouvrages m’intéressaient même s’ils ne parlaient pas de science fiction ou de super héros. Grâce à eux, j’explorais l’esprit quasi insondable de mon oncle. La curiosité devint une passion et c’est grâce à lui si je suis aujourd’hui paysagiste et membre d’une section de recherches biologiques sur les mammifères marins. Et c’est grâce à ma tante, qui possédait des œuvres sur les chimères et autres bêtes extraordinaires, que je suis devenu un spécialiste des contes et légendes du monde.
Aujourd’hui, je rends une énième visite à miss Hamond. Comme à son habitude, elle me propose un thé dans sa petite cuisine. Cela fait bien quinze ou seize ans qu’elle ne voyage plus, sa santé laisse à désirer. Elle n’est certes pas aussi pleine d’énergie et de joie que lorsque j’étais jeune, mais dans son regard, dans sa voix et dans chacun de ses gestes, il reste toujours une once de jeunesse. Comme si son esprit demeurait immortel. Je l’observe boire son thé tranquillement, je l’écoute me conter une de ses folles aventures.
Alors qu’elle me raconte comment l’oncle Bart a échappé de justesse de la gueule d’un crocodile du Nil, lors d’une virée en felouque, j’aperçois un étrange objet au-dessus de la petite cheminée. Ce n’est pas dans les manières de miss Hamond, de laisser traîner ses affaires, et l’oncle Bart n’est malheureusement plus là pour le faire. Alors je m’interroge. Pourquoi a-t-elle laissé cela ici ? Et d’ailleurs, quel est cet objet ? Je m’approche et l’observe. C’est un petit flacon de parfum en verre dépoli, dont les dessins mauves et bleus se succèdent de façon fluide. Il est allongé vers le haut, et sa silhouette n’est pas sans rappeler les flacons orientaux. Son capuchon s’arrondit élégamment et forme une pointe à son extrémité. Il ne paraît pas bien vieux, je ne vois aucune marque que le temps aurait laissée. Miss Hamond a probablement acheté cet objet il y a peu de temps. Ma tante s’approche à son tour.
_ Il est beau, n’est-ce pas ?
_ Plutôt, dis-je.
_ Cela faisait des mois que je le cherchais pour te le montrer.
_ Des mois ?
Ma tante n’est pas du genre à perdre ou à oublier des objets. Et elle n’est pas non plus du genre à me mentir.
_ C’est que j’y ai pris le plus grand soin. Sais-tu où j’ai découvert cet objet ?
_ Non.
Elle le prend dans ses mains et le fait tourner, avec son calme et son raffinement habituels.
_ C’est une vieille commerçante qui me l’a vendu dans un marché en Arabie Saoudite. J’avais eu le coup de cœur pour ce flacon. C’était quelques temps à peine avant de rencontrer Barthy.
Oubliée l’histoire de l’oncle Bart luttant contre un alligator d’Égypte. L’objet toujours entre les mains, comme s’il s’agissait de la huitième merveille du Monde, elle retourne lentement s’asseoir à la table en bois de la petite cuisine. Elle ne le pose pas immédiatement. Elle l’observe et le fait encore tourner entre ses doigts fins et agiles. Je la rejoins et porte la tasse de thé à mes lèvres.
_ Cet objet, dit-elle, n’est pas à mettre derrière une vitrine. Il est différent des autres. Les lances masaïs, les sculptures égyptiennes, les objets incas, les boucliers celtes, ce ne sont que des babioles de foires en comparaison.
C’est bien la première fois qu’elle converse sur un tel ton. D’habitude, elle me parle avec cette voix un peu fluette qui trahit son excitation à l’idée de revivre une de ces multiples aventures en me la contant. A présent, il y a une touche de gravité dans sa voix. Comme si elle voulait me dire « maintenant, je vais te parler comme à un adulte ». Et je me demande bien en quoi un flacon de parfum peut être plus important que des objets d’une telle valeur sentimentale, et historique. Connaissant ma tante, je sais qu’elle ne compte pas s’arrêter là, alors j’attends qu’elle choisisse elle-même les bons mots à dire. Son regard s’assombrit un peu.
_ Tu sais, reprend-elle. Si je ne t’en ai jamais parlé, c’est parce que je pensais avoir tout le temps devant moi. Mais je me rends compte à présent que rien n’est moins sur.
Je regarde ma tasse, sans y boire, et plisse un instant les lèvres.
_ Barthy, il était de ceux qui ne croient que ce qu’ils voient. Il m’a toujours ri au nez quand je lui parlais du flacon.
_ Et qu’a-t-il, ce flacon ?
_ Il est magique !
Je reste interdit. Connaissant feu le mari de ma tante, je l’imagine en effet très bien se moquer d’elle à l’idée qu’elle tient un flacon qu’elle dit « magique ». Elle pose la fiole sur la table, non loin d’elle, comme si cela lui permettait de vivre plus longtemps.
_ Tu sais Phil, continue-t-elle, je me fais vieille. J’ai besoin de t’en parler avant qu’il soit trop tard.
Je sais que miss Hamond n’a pas une santé de fer, et je sais que tenter de la rassurer avec des « mais non, tu te fais trop de soucis » ne servirait à rien. Alors, je me tais. Elle prend une gorgée de son thé, sans quitter le flacon des yeux.
_ Il n’est pas ordinaire, dit-elle finalement. Il n’y a jamais eu la moindre vapeur de parfum à l’intérieur. Il n’était pas fait pour ça. Si tu retires l’opercule, il s’échappe… enfin il s’échappait, une bête extraordinaire.
D’une part, j’ai envie de croire qu’elle n’est pas sérieuse. D’autre part, le regard et le ton qu’elle emploie ne me laissent pas le moindre doute quant à la véracité de ses propos. J’ai toujours pu avoir confiance en elle, et je sais qu’elle n’est pas du genre à se moquer de moi. Pourtant, je n’arrive pas à me faire à l’idée qu’un monstre puisse sortir d’un objet si petit.
_ Vraiment ?
_ Bien sur ! Répond-elle avec hardiesse. Et crois-moi, j’en ai vu des choses invraisemblables.
Finalement, je commence à croire qu’oncle Bart avait peut-être raison. Tandis que je la regarde d’un air perplexe, elle se lève d’un bond – elle qui est si fragile – et va fouiller parmi ses livres de cuisine, non loin de la cheminée. Elle cherche, frénétiquement, écarte les gros livres et fouine comme si sa vie en dépendait.
_ Ah le voilà, dit-elle.
Elle sort un livre assez fin pour ne pas être vu entre les gros ouvrages culinaires.
_ Regardes par toi-même.
Et elle me lance l’objet, qui s’ouvre en plein vol et atterrit entre mes mains, toujours ouvert en son centre. Sur chaque feuille, des pages de journal déchiré. A gauche, un titre parlant d’un certain loch. L’article est en anglais et mentionne plusieurs témoignages selon lesquels une bête étrange y avait été vue. La photo au centre, montre la forme floue. Elle est bien trop connue des fanatiques du paranormal et de l’étrange pour que je ne fasse pas le rapprochement avec le premier voyage de miss Hamond en Écosse, la patrie natale d’oncle Bart. La silhouette du monstre se découpe grossièrement du lac dans lequel il baigne. En dessous, à la main, est notée la date 1973. Je reconnais sans peine l’écriture de ma tante.
Sur la page de droite, la photo de journal montre un grand pygargue, survolant les rocs clairs des vastes étendues rocheuses d’Amérique du nord. Le titre disait « A Thunderbird in Colorado ». J’ai lu dans un livre de contes et légendes amérindiens que ces bêtes ressemblent à des aigles gigantesques aussi vifs que la foudre, et dont le battement d’ailes avait le bruit caractéristique du tonnerre, d’où leur nom d’oiseaux-tonnerre. Correspondant à l’un de ses voyages aux Amériques, la date 1982 figure avec la même écriture tout en bas de la page.
Mes yeux se tournent vers ma tante, puis de nouveau vers le livre. Je le feuillette doucement, et observe finement chaque image.
Entre une immense forme blanche dans la neige, que les amateurs connaissent sous le nom de Big Foot, une espèce de chacal à la colonne vertébrale étrangement développée, que certains appellent Chupacabra, et ce que je peux aisément prendre pour un photomontage représentant Cerbère le chien à trois têtes de la mythologie grecque, des dizaines d’autres figures fabuleuses et totalement invraisemblables se succèdent sous mon regard effaré. Et à chaque feuille de journal déchirée, est ajoutée une date de voyage, parfois accompagnée de quelques commentaires.
Je reporte mon attention sur le flacon, puis ma tante.
_ Mais alors…
_ Oui, répond-elle. Certaines de ces bêtes ont prit vie grâce à lui. Je l’ai moi-même utilisé. Autrement, il ne serait pas vide.
De nouveau, le doute s’empare de moi. Miss Hamond est du genre à dire des choses extravagantes, elle le faisait déjà quand elle racontait ses voyages aux quatre coins du monde. Ses récits étaient un peu abracadabrantesques, mais c’était uniquement pour ajouter un peu de fantaisie à ses histoires. Pour cette fois, le ton de sa voix n’est pas aux contes pour enfant. Et pourtant, je me demande encore si elle n’affabule pas.
_ Une fois, il en est même sorti une fée.
_ Une fée ?
_ Oui ! Elle était petite comme mon pouce, et elle avait dans le dos des ailes de libellule. Et elle brillait d’une lumière douce. Pour me remercier de l’avoir libérée, elle m’a demandé de faire un vœu. Sais-tu quel a été mon vœu ?
_ Non, dis-je.
_ Je lui ai demandé que Barthy et moi soyons toujours ensemble, quoiqu’il arrive. Et elle l’a réalisé. Il est toujours là, tu sais !
La mort de mon oncle fut un choc intense pour miss Hamond. Il était le seul homme qu’elle ait aimé. Elle en tomba gravement malade, et ne cessait de le chercher. Mais du jour au lendemain, elle perdit tout chagrin. Il était revenu, disait-elle, et il serait près d’elle à tout jamais. Ma mère, qui était déjà souvent en conflit avec elle au vu de la vie que chacune menait, décida de couper les ponts. Mais j’étais trop attaché à elle pour faire de même, et tous les mois, je suis venu la voir malgré cela.
_ Il est là, reprend-elle. Il vit surtout dans la forêt, sous sa forme originelle. Mais des fois, il vient me tenir compagnie.
Les histoires qu’elle me racontait quand j’étais enfant, me transportaient dans un monde imaginaire, mais j’ai toujours su garder les pieds sur terre, ainsi qu’une façon de penser relativement commune à tous les êtres humains dits normaux. Je suis un peu comme l’oncle Bart, au fond : je ne crois réellement que ce que je vois, sans qu’il y ait eu photomontage. Pour moi, c’est totalement fou, totalement incohérent, totalement irréaliste. Et pourtant, miss Hamond semble si certaine, quand elle dit cela, que je ne sais plus quoi penser.
Nous finissons de boire le thé, comme si rien de tout cela ne s’était passé. Et alors que le soleil commence à embrasser l’horizon dans une couleur ambrée, je quitte sa maison. Je lui fais un dernier signe de la main, et, entrant dans ma voiture, je pose le paquet sur le siège passager, avant de le regarder quelques secondes. Elle a tenu à me donner le flacon de parfum ainsi que le petit cahier dont elle a rempli les pages avec des articles de journaux.
Je fais doucement le chemin entre sa maison et le grand portail du domaine. A ma gauche, en contre-jour, les hectares de vignes que possède encore ma tante. A ma droite, éclairées par le soleil couchant, les forêts où j’allais jouer quand j’étais enfant.
Un mouvement dans un coin, me fait tourner le regard. Entre les arbres de la forêt, un élégant étalon à la robe pie m’observe. Il se dresse un instant sur ses pattes arrière. Mais avant que j’ai le temps de le détailler, il disparaît dans la pénombre de la forêt au grand galop. Je reste coi, tandis que sa croupe s’estompe dans les ténèbres, incapable de la moindre pensée.
Un bref instant, j’ai bien cru voir une protubérance sur son front.
| |
|   | | Rena Circa le Blanc
Plume Novice

Messages : 25
Date d'inscription : 18/01/2015
 |  Sujet: Re: Enchantements Sujet: Re: Enchantements  Lun 26 Jan 2015 - 22:55 Lun 26 Jan 2015 - 22:55 | |
| Les yeux du félin A l’époque où tu n’étais qu’une jeune deika, la vie était pour toi un vaste jeu. Avide de découvertes et de sensations fortes, tu ne cherchais qu’à courir après les souris et les papillons. Tu étais la vivacité incarnée. Plus le temps avançait, plus ton pelage gris s’épaississait et gagnait en beauté. Tu avais tous les airs d’une douce et docile créature, mais ton apparence de chat ne trompait personne : avec tes deux mètres de haut, ta stature imposante et ton regard d’acier, tu étais un de ces majestueux félins géants, puissants et redoutables.
Ton œil vert perçant visait là où celui de l’être humain ne pouvait pas aller. Ton odorat affuté trouvait même la plus fine miette cachée sous les plus larges fourrés. Ton ouïe exceptionnelle pouvait entendre jusqu’aux respirations de ton maître dans la maison d’à côté. Et jamais tu ne doutais de toi ou de lui. Vivant dans une vaste maison jouxtée à une bergerie, tu t’en étais fait la gardienne. Pas un loup ne passait la frontière de ton territoire sans que tu ne le chasse. Pas un ours n’osait jouer avec les moutons de ton domaine. Tu aimais la vie, tu la savourais comme tu dégustais ces rochs que tu chassais en été, et tu ne cessais de te vanter dans ton langage félin d’être la reine de ces lieux. Pour toi, la vie ne se limitait pas à respirer, manger, et dormir. Tu étais curieuse de tout, et tu protégeais jalousement ces brebis et ce maître que tu aimais tant.
Et puis est venu le jour où tu as perdu ta patte avant droite. Le maître avait mis le domaine à la vente, et les brebis n’étaient déjà plus là. Tu as fais une dernière inspection de ton territoire, avant de quitter les lieux, mais on avait oublié de retirer un des pièges à ours qui avaient été posés devant la bergerie. Petit défaut d’inattention, tu ne l’as pas vu et tu as marché dessus. Sitôt le déclic du mécanisme du piège déclenché, tu as compris ton erreur… mais il était trop tard. La morsure du métal sur ta patte fut si puissante qu’elle sectionna à moitié la chair et les os. Si l’on ne t’avait pas porté secours, tu aurais succombé à ta blessure. Fort heureusement, tu fus sauvée, en échange de ta patte meurtrie.
Après avoir été brièvement soignée, et devenue un fardeau pour ton maître plus qu’une aide, tu as été abandonnée dans cet endroit qui t’a vue naître et grandir, seule avec toi-même. Incapable désormais de te nourrir par toi-même, tu as survécu à grand peine, grâce aux maigres offres que te faisaient les nouveaux maîtres des lieux. Et l’être humain t’a tant déçu que tu as préféré t’en écarter pour finir ta vie de deika en solitaire. La vie n’a plus eu le même goût, les renards et les rochs ont envahi l’endroit, et tu as laissé dépérir ton ouïe, ton odorat et ta vue. Au bout de quelques années, tu as même fini par oublier de lustrer ta si belle pelisse angora aux multiples teintes de gris.
Puis est arrivé ce soir d’octobre, où la pluie tombait dru sur ton poil hirsute. Tu as préféré ce soir-là te blottir contre la grande vitre de mon appartement, à l’abri derrière les volets entrouverts, plutôt que de supporter une nouvelle fois le froid te mordre jusqu’aux os. Je t’avais déjà vue rôder dans les parages, cherchant à grappiller des restants de dîner des propriétaires à qui je louais mon appartement. M ais à chaque fois que je tentais de t’observer plus longtemps ou de t’approcher, il suffisait que je tourne le regard et tu disparaissais comme une ombre. Souvent, j’ai eu l’occasion de voir dans tes yeux. Mais je n’y avais jamais décelé quoi que ce fût de différent des autres animaux.
J’ai croisé une fois de plus ton regard, ce soir-là. Tu n’avais rien d’une de ces bêtes immenses dont on dit qu’elles sont aussi puissantes et dangereuses que les ours. Tu avais un regard de chat. J’ai pu voir dans tes yeux toute la tristesse du monde. Refusant de te laisser seule sous cette pluie battante, j’ai ouvert ma baie vitrée. Et en voyant que j’avais préparé du lait et une pièce de lard, tu n’as pas su résister au confort qui s’offrait à toi. Tu as tout bu, tout mangé, non loin du radiateur qui diffusait sa chaleur bienveillante alors que dehors, la tempête faisait rage. Puis tu t’es installée en attendant la fin du déluge, et je t’ai séchée en frottant ton pelage trempé. Tu t’es endormie non loin de mon lit, en ronronnant. Au petit matin, comme le ciel était bleu et sans nuages, tu as voulu partir. Mais à mon grand soulagement, tu es revenue le soir.
Tu as vite repris des forces, et tu as même recommencé à prendre soin de ton pelage. Chaque jour se passait le même rituel : tu venais me réveiller avec une léchouille sur ma joue, et ton vieux miaulement semblable à un grincement de porte, je te donnais à manger et je te laissais la baie vitrée ouverte pour que tu puisses sortir. Toute la journée, chacune de nous vaquait à ses occupations, et le soir venu, tu m’attendais devant la porte de mon appartement, je te faisais rentrer, te donnais à manger, et tu venais t’asseoir près de moi pendant que je terminais ce que j’avais à faire. Tu aimais t’allonger et me regarder faire toutes ces choses typiquement humaines. La seule chose que tu n’aimais pas, c’était que je joue de ma guitare. Cela te rappelait ton passé douloureux, sans doute tes années auprès de ton maître. Ou peut-être cette journée où pour toi, tout a basculé. Puis lorsque j’allais me coucher, tu t’installais à côtés de mon lit, la tête posée contre ma joue, et ton ronronnement bruyant en guise de berceuse. Parfois, tu ronronnais si fort que les murs en tremblaient.
Nous n’avions pas besoin de communiquer pour nous comprendre. Nous étions complémentaires, toi et moi. Nous avions fui toutes les deux les êtres humains dans leur majorité, conscientes que notre bonheur n’était pas d’être parmi eux. Et non contentes de nous compléter, nous étions attirées l’une vers l’autre, comme des aimants. Sachant que tu étais très vieille, je ne passais pas un jour sans me perdre au moins une fois dans ta fourrure généreuse pour te serrer contre moi. Et j’aimais alors t’entendre ronronner si fort que l’appartement tout entier ronronnait avec toi.
Quel dommage que je ne t’ai connue qu’à la fin de ta vie. Tu avais déjà trente cinq ans, à peine plus que moi. Mais les années du félis deika ne sont pas celles de l’homo sapiens et je savais que tu avais déjà une longévité exceptionnelle en connaissant les conditions de vie que tu avais dû subir pendant toutes ces années. L’absence de ta patte ne te dérangeait pas vraiment, la vieillesse ne semblait pas avoir une grande emprise sur toi, et la viande que je te préparais n’offrait pas beaucoup de résistance à tes crocs pourtant émoussés. Je prenais soin de toi, autant que faire se pouvait. Et tu t’occupais de soigner mes blessures de cœur et d’esprit.
Plus les jours passaient, plus je gardais espoir que tu resterais avec moi, malgré cette petite voix dans ma tête, qui me rappelait constamment que ton temps était compté. J’avais même parfois l’impression que tu rajeunissais, tant ta force vitale te rendait belle, jeune et indestructible. Mais bien sur, tu n’étais pas immortelle… Cela faisait quatre ans que nous nous étions trouvées, et je détournais mon attention de ton souffle grinçant, et de ta démarche claudicante. C’est ton ronronnement constant qui me mettait dans l’erreur. Ou bien mon amour pour toi, qui me forçait à ne pas voir les signes avant-coureurs.
Et cette nuit est venue. Toute la journée, tu es restée près de moi, à réclamer toute mon attention pour des caresses et des sorties. Plus qu’à l’accoutumée, tu étais aussi proche de moi que possible. Il ne se passait pas un instant sans que tu cales ta tête contre mon épaule ou que tu ne me bouscule gentiment dès que je tournais le regard. Cela me plaisait bien sur, alors je restais près de toi, à répondre à tes demandes.
Puis le soir arrivé, tu as commencé à lécher la plaie de ta patte manquante. Elle semblait te démanger, et tu y as mis tant d’effort qu’elle s’est ouverte à nouveau. J’ai eu beau essuyer le sang, rien n’y a fait. C’est alors que tu as commencé à avoir du mal à respirer. Tu as craché un peu de sang, et tu n’as pas osé me laisser spectatrice de cette scène macabre. Sans attendre mon avis, tu as quitté l’appartement, non sans briser la porte pour y parvenir. Et tu as couru dans le champ qui jouxtait le domaine. Je n’ai pas pu m’empêcher de te suivre, après avoir repris mes esprits. Malgré ta patte en moins, ton âge avancé et le sang qui te quittait, tu avais encore une telle puissance qu’il m’a fallu, pour savoir où tu allais, te suivre des yeux. Puis, lorsque tu as été hors de vue, j’ai dû écouter tes râles pour te suivre. Tu étais encore trop rapide pour moi. Mais finalement, je t’ai trouvée, allongée contre un petit frêne qui ne payait pas de mine, tout en haut d’une colline avoisinant ton domaine. Tu avais cessé ta course folle, fatiguée, et tu te tenais là, appuyée de tout ton poids contre l’arbre fin, le souffle court et sifflant, observant devant toi comme si tu poursuivais une proie.
J’ai eu peur que tu me repousse, quand je t’ai rejointe. Mais tu as finalement accepté ma présence. L’une comme l’autre, nous savions que le moment tant redouté était arrivé, et ne souhaitions pas que tu le vives seule. A bout de souffle, je me suis assise près de ta tête, que tu as posée sur mes genoux. J’ai pu entendre encore une vague de tes ronronnements puissants, avant que quelques réflexes ne les arrêtent. Puis tu as cessé de respirer, après un long et douloureux souffle. C’est lorsque ta tête est devenue lourde sur mes genoux et que le silence a repris sa place, que je me suis rendue compte que quelque chose m’avait été retiré. Alors, moi qui m’étais promis de rester forte jusqu’au bout, je n’ai pas tenu un instant de plus. Et je me suis effondrée en larme sur ton corps.
Finalement, c’est cet endroit que j’ai choisi pour toi. C’était la place idéale. Ce petit frêne qui te surveille n’est pas vieux, mais il est solide. Pour avoir supporté ton poids quand tu t’es appuyé sur lui, il a bien mérité d’être ton gardien. J’ai creusé tout le jour, et le soir venu, je t’ai emmitouflée dans un drap que tu aimais bien, avant de te pousser dans ta dernière demeure. Je me souviens t’avoir dis que la vue était magnifique. Tu peux surveiller tes champs, et faire la chasse aux rochs. Et la nuit venue, c’est l’endroit idéal pour regarder les étoiles. Depuis que tu es partie, je les regarde souvent, comme si je pouvais t’y voir. Elles m’aident à garder un souvenir de toi. Et quand je repense à toi, ce que je vois en premier, c’est ton regard. Tes yeux verts fendus au milieu d’une épaisse fourrure grise, et au-dessus d’un museau retroussé.
J’ai du quitter mon appartement. Ton souvenir y était trop ancré pour que je puisse le garder plus longtemps : chaque pas me brûlait les pieds, chaque respiration me brisait les côtes. Mais la distance qui me sépare désormais de toi me tue plus encore. Chaque jour, c’est l’absence de ton miaulement rauque qui me réveille, et chaque soir, il me manque tes ronronnements pour dormir correctement. Je suis en mal de toi, mon amie deika, ma sœur d’esprit, la jumelle de mon âme. Toi qui étais là pour soigner ma tête quand je soignais ton corps, toi qui étais là pour que je perde mon regard dans tes yeux magnifiques.
Merci pour ces quatre années de bonheur. | |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Enchantements Sujet: Re: Enchantements  | |
| |
|   | | | | Enchantements |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |